Critique de Miley Cyrus et les malheureux du siècle. Défense de notre époque et de sa jeunesse, de Thomas O. St-Pierre, Montréal, Atelier 10, coll. « Documents » (13), 2018, 105 p.
Par Simon Labrecque, Montréal
—
Le temps qu’on a pris
pour dire « je t’aime »
c’est le seul qui reste
au bout de nos jours.
Gilles Vigneault, « Gens du pays »
 Dans Miley Cyrus et les malheureux du siècle, Thomas O. St-Pierre propose une « défense de notre époque et de sa jeunesse » placée sous un signe étrange, qui demeure en bonne partie caché, dans l’essai : l’amour. Entre la « modophobie », la peur anxieuse et dédaigneuse de l’ère contemporaine, et la modophilie, sa vénération éhontée et non critique, une ligne d’acceptation lucide, un sillon réflexif se trace en effet, sous la plume de St-Pierre, relançant ce que Friedrich Nietzsche appelait l’amor fati, l’amour du destin, et ce que Hannah Arendt appelait l’amor mundi, l’amour du monde. Comment recevoir un tel livre, au Québec, aujourd’hui?
Dans Miley Cyrus et les malheureux du siècle, Thomas O. St-Pierre propose une « défense de notre époque et de sa jeunesse » placée sous un signe étrange, qui demeure en bonne partie caché, dans l’essai : l’amour. Entre la « modophobie », la peur anxieuse et dédaigneuse de l’ère contemporaine, et la modophilie, sa vénération éhontée et non critique, une ligne d’acceptation lucide, un sillon réflexif se trace en effet, sous la plume de St-Pierre, relançant ce que Friedrich Nietzsche appelait l’amor fati, l’amour du destin, et ce que Hannah Arendt appelait l’amor mundi, l’amour du monde. Comment recevoir un tel livre, au Québec, aujourd’hui?
J’avais des attentes assez précises face à ce livre, selon mes rapports à l’auteur et à Miley Cyrus. J’ai fréquenté la même école secondaire que St-Pierre, un an avant lui, et j’ai beaucoup aimé son premier roman, Même ceux qui s’appellent Marcel (Leméac, 2014), que j’ai louangé dans une recension parue dans Trahir en septembre 2014. Tout en reconnaissant que je mobilisais un cliché, j’affirmais alors avoir trouvé « la voix d’une génération », liée à un contexte géographique, culturel et socio-économique précis (celui des natifs de banlieues de la ville de Québec, au milieu des années 1980). Sur le plan très personnel de ma trajectoire d’écriture, je considère aujourd’hui cette recension comme un point tournant, un texte où quelque chose s’est infléchi et dénoué, pour moi, quant au temps et à l’espace, et quant à la littérature et à la voix « personnelle », justement. C’est pour cela, je crois, que je ne me suis toujours pas résolu à lire le deuxième roman de St-Pierre, Charlotte ne sourit pas (Leméac, 2016). Si tout dénouage implique en fait un renouage, ou un nouage autre, sur une autre scène[1], je crains les effets que cette lecture supplémentaire pourrait avoir sur le filet symbolique artisanal que je me suis rapaillé depuis.
Cependant, lorsque j’ai appris que Thomas O. St-Pierre allait publier un essai dans la collection « Documents » d’Atelier 10, j’ai immédiatement envisagé le lire et écrire une critique, si ce n’est que pour participer, par mes très modestes moyens, à faire connaître ce livre. Cette possibilité s’est tout de suite transformée en certitude lorsque j’ai lu le titre et le sous-titre : Miley Cyrus et les malheureux du siècle. Défense de notre époque et de sa jeunesse. Je l’ai lu comme la promesse d’une brèche, dans un contexte médiatique saturé de discours sur le présent qui cherchent à distribuer les louanges et les blâmes de façons qui sont beaucoup trop répétitives et prévisibles pour être véritablement intéressantes. Publier dans la collection « Documents », c’est une chance de rejoindre des centaines, sinon des milliers de personnes, pour dire autre chose, ou pour parler différemment – à moins de considérer qu’Atelier 10 occupe déjà une place bien définie dans ce jeu, ce dont je ne suis pas certain.
Quoi qu’il en soit, c’est par le nom de Miley Cyrus que j’ai d’emblée préparé mon entrée dans le texte de St-Pierre. Mon objectif premier, en achetant le livre, étant de voir s’il disait quelque chose sur les relations entre la célèbre chanteuse de Wrecking Ball, née (après nous) en 1992, et le groupe rock psychédélique The Flaming Lips, formé à Oklahoma City en 1983 (avant notre naissance). Si je ne trouvais aucune mention de ces relations, je prévoyais proposer un « complément d’enquête » en présentant la collaboration entre Cyrus et les Flaming Lips, depuis 2014, comme un exemple intéressant de transmission intergénérationnelle. Si je trouvais quelque mention de cette collaboration, je prévoyais articuler ma critique du livre à l’évaluation de cette mention. Puisqu’il est brièvement question des Flaming Lips, dans l’essai de St-Pierre, c’est la seconde option qui organise le présent texte. Par ce filon, c’est d’amour qu’il sera question – ou plutôt, c’est le pouvoir attribuable à l’amour qui deviendra une question.
All You Need Is Love
L’essai de Thomas O. St-Pierre est divisé en quatre parties principales, précédées d’une introduction (« pourquoi Miley Cyrus? »), et suivies d’une conclusion (« la tentation des âges d’or »). La première partie, « La jeunesse : notes sur une fascination paradoxale », inclut un court chapitre intitulé « Mode d’emploi : Tonner contre l’époque », qui rappelle le Dictionnaire des idées recevables, carnet jadis animé par l’auteur. Un intermède sur le rapport des jeunes aux médias sociaux et aux nouvelles technologies, nourri par l’expérience de l’auteur comme professeur de philosophie au collégial pendant cinq ans, s’intitule « La haine de soi ». Il mène à la deuxième partie, « Le succès : Notes sur l’expressions contemporaine d’un rapport ambigu ». Cette fois, le « mode d’emploi » porte sur « Faire oublier son succès », et l’intermède, qui s’intitule « La fin du monde », porte sur la tendance de chaque époque à se comprendre sous le signe de l’apocalypse. La troisième partie, « La scène et le spectacle : Notes sur la représentation et les réseaux sociaux », aborde avec humour les difficultés de la construction de soi, avec un mode d’emploi glosant comment « S’indigner sur les réseaux sociaux ». Enfin, la quatrième partie, « Pour la suite du monde : Notes sur la transmission », propose une méditation sur le film célèbre de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière (ONF, 1963), entremêlée de réflexions sur « l’ère Trump » et sur la vie de plus en plus rangée de Miley Cyrus, selon l’image qu’elle projette désormais dans les médias internationaux[2].
Miley Cyrus, ex-enfant star devenue un symbole de la musique pop sexualisée à outrance, est au centre de cet essai, car elle est « [l’]objet privilégié du mépris contemporain » (p. 15). Elle agit comme une loupe, comme un miroir, ou comme une boule disco de démolition, si l’on sait chevaucher les symboles… et se laisser séduire par la chaine signifiante. La mention des Flaming Lips survient dans la deuxième partie de l’essai, qui porte sur le succès. Le troisième chapitre de cette partie se lit ainsi :
Miley ne possède aucun de ces accessoires – diplômes, compétences extracurriculaires, laideur ou ton iconoclaste – qui lui permettraient de se faire pardonner sa popularité. Il lui faut chercher ailleurs pour être acceptée.
En 2015, après le succès de Bangerz qui a été le véhicule de son virage sexuel, Miley sort un album intitulé Miley Cyrus & Her Dead Petz. Il est produit en collaboration avec les Flaming Lips, un groupe qui doit lui permettre, grâce à une osmose vampirique, d’augmenter sa crédibilité artistique.
L’album se veut « expérimental » et « psychédélique », il ne fait l’objet d’aucune campagne de promotion, il est offert discrètement et gratuitement sur l’internet. À son sujet, Miley a déclaré que ce projet était avant tout musical et qu’il n’avait rien à voir avec le twerking.
Tous les signaux sont clairs : Miley ne cherche plus à plaire, mais à impressionner. Elle ne veut plus séduire, mais être reconnue comme artiste sérieuse. Elle veut manger à la table des adultes.
L’album reçoit des critiques mitigées. Personnellement, je ne suis jamais tombé ni sur un clip partagé sur un réseau social, ni sur un article en parlant, ni sur quoi que ce soit s’y rapportant. Je n’ai même jamais entendu aucune de ses chansons. J’ai lu à son sujet parce que j’écris ce livre, sinon je ne saurais même pas que ce disque existe.
Voilà un bon chemin pour se faire pardonner sa popularité : ne plus être populaire (pp. 53-54).
Si la collaboration entre Miley Cyrus et les Flaming Lips, pour Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), était une stratégie orchestrée par RCA Records, le label de Cyrus, ou par la chanteuse elle-même, afin « d’augmenter sa crédibilité artistique », il semble bien que je sois la preuve vivante du succès de cette stratégie! En effet, l’apparition de la chanteuse sur l’album With a Little Help from My Fwends (2014), où les Flaming Lips reprennent en entier Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), des Beatles, avec plusieurs autres collaborateurs, m’a convaincu de l’intérêt véritable de Cyrus pour la musique, ou encore, de son intérêt pour la « véritable musique ». Pour cela, il fallait que j’aie déjà de singuliers préjugés au sujet des Flaming Lips… Le rapprochement de l’une et des autres a créé un lien, un pont permettant aux préjugés favorables de déteindre, par une sorte de contagion par proximité, ou de « ressemblance par contact[3] ».

Wayne Coyne des Flaming Lips et la chanteuse Miley Cyrus interprètent « Lucy In the Sky » lors de la cérémonie des Billboard Music Awards de 2014 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas le 18 mai 2014.
Sur le disque des Flaming Lips, les reprises de Lucy in the Sky With Diamonds et A Day in the Life, avec Cyrus, sont remarquables, si ce n’est que par la voix de la chanteuse. Elles s’inscrivent en continuité avec la pratique expérimentale du groupe, qui ont déjà produit un album de quatre disques devant être diffusés en même temps par quatre systèmes de son (Zaireeka, 1997), qui ont repris l’entièreté de l’album Dark Side of the Moon (1973), de Pink Floyd, avec Stardeath, White Dwarfs, Henry Rollins et Peaches, en 2009, et qui venaient tout juste de reprendre la chanson All You Need is Love, des Beatles, à la fin de l’album The Terror (2013). Cet album marquait un moment sombre dans l’histoire tumultueuse du groupe psychédélique, le chanteur Wayne Coyne s’étant récemment séparé de sa femme, avec qui il formait un couple apparemment heureux depuis plusieurs décennies. Le musicien et compositeur principal du groupe, Steven Drodz avait, pour sa part, recommencé à consommer de l’héroïne, un épisode qu’il racontera comme « une rechute ». Dans ce contexte, n’était-ce pas plutôt la jeune Cyrus qui venait redonner de l’énergie aux vieillissant(e)s Flaming Lips? C’est parce que je croyais intuitivement que cela était le cas que Cyrus m’a soudain semblé particulièrement sympathique. Elle me semblait avoir compris quelque chose, et je croyais lui devoir une énième « renaissance » du groupe d’Oklahoma City. J’ai aimé Miley parce qu’elle aimait et aidait un groupe que j’aimais, semblant, par son amour, lui permettre de continuer à être un objet d’amour.
Donnant, donnant
Les Flaming Lips sont connus pour produire des chansons étranges, parfois très longues et bruitistes, parfois courtes, très mélodiques et harmonieuses, sur des thèmes graves comme la mort et l’effondrement, entremêlées de références fantastiques et colorées aux licornes, aux savants fous et aux extra-terrestres. Leur plus grand succès, « Do You Realize?? », est exemplaire :
Do you realize that you have the most beautiful face?
Do you realize that we’re floating in space?
Do you realize that happiness makes you cry?
Do you realize that everyone you know someday will die?
And instead of saying all of your goodbyes, let them know
You realize that life goest fast
It’s hard to make the good things last
You realize the sun doesn’t go down
It’s just an illusion caused by the world spinning round
Les spectacles des Flaming Lips sont ponctués de jets de confettis et de paillettes, de musiciens costumés, ainsi que d’excursions du chanteur, debout sur la foule, dans une « bulle de hamsters pour humains ». Le mélange n’est pas kitsch, dans la mesure où l’on peut sentir qu’il s’y crée du nouveau, même si c’est parfois avec difficulté.
Lorsque j’ai assisté au spectacle du groupe, à Québec, en août 2014 (tout juste avant de lire le premier roman de St-Pierre), je faisais partie d’une foule étonnamment peu nombreuse. À Expo Québec, Éric Lapointe avait eu beaucoup de succès, cette année-là (comme toutes les autres)… Cependant, au sein de cette petite foule compacte, une reconnaissance et une gratitude singulières se sont manifestées dans les nombreux croisements de regards complices de celles et ceux qui forment la petite « scène indie » de Québec, qui voient encore dans le psychédélisme une forme de résistance, et qui font l’expérience de la musique vibrante comme d’un chemin de guérison, ou du moins, une voie d’expression de tout ce qui est « dur à dire », mais qui insiste pour sortir, surtout si on cherche à l’ignorer. Je parierais que plusieurs membres de cette foule ont récemment participé aux Nuits psychédéliques, à la coopérative Méduse, avec les Martyrs de Marde et Simon-Pierre Beaudet. Plusieurs ont aussi manifesté contre le G7, malgré la peur amplifiée par tous les médias, sous l’impulsion du bras armé de l’État. Malgré la petite foule, en tous cas, les Flaming Lips se sont véritablement donnés, ce soir-là.
L’amitié salvatrice entre Coyne et Drodz est devenue légendaire, pour les fans. Elle est à l’origine de The Spiderbite Song, par exemple, sur une « piqure d’araignée » sur la main du guitariste, qui s’est avérée être un abcès infecté, causé par l’usage de drogues intraveineuses.
When you had that spiderbite on your hand
I thought we would have to break up the band
To lose your arm would surely upset your brain
The poison then could reach your heart from a vein
I’m glad that it didn’t destroy you
How sad that would be
‘Cause if it destroyed you
It would destroy me
Dans ses paroles, on sent aussi un certain égoïsme dans l’amitié de Coyne pour Drozd… Quoi qu’il en soit, cette mythologie du groupe colore les chansons et la manière dont elles sont reçues. Dans une entrevue très récente, au début de la tournée qui mènera le groupe à Montréal, à la fin de l’été, Wayne Coyne décrivait ainsi l’effet de leurs performances, à l’intention des nouveaux venus :
I think our music is emotional at times – our audience does have a deep connection to what the songs are about. If you’re not ready, you might be stood next to people crying and having what, some might say, is a struggle but what it is actually is some form of powerful experience connected to one of our songs. We encourage that in our audience, don’t hold back, if you feel like you’re overwhelmed by a song, that’s okay.
Notons que les sites internet, y compris celui de NME, qui publiait l’entretien, en ont principalement retenu une blague de Coyne, à l’effet que le groupe pourrait inclure de l’urine de Miley Cyrus dans des disques vinyles à venir, après avoir inclus du sang de ses collaborateurs, puis une bière brassée pour les Flaming Lips, dans d’autres disques vinyles. Les commentaires des internautes témoignent du fait que le mépris pour Cyrus a en quelque sorte été transféré aux Flaming Lips, du moins pour celles et ceux qui voient dans les paillettes une façon de camoufler ce qui serait un manque de talent.
Mon interprétation de la collaboration avec Cyrus était plus généreuse : j’y voyais une forme d’amitié intergénérationnelle, la jeune chanteuse aidant le groupe à se relever d’évènements difficiles, mais le groupe aidant aussi la star à assumer, sinon à découvrir, son propre côté expérimental, et le tout, en donnant à lire quelques traces bizarres dans les médias du « showbiz », comme autant d’anecdotes à méditer sur la transmission et les alliances possibles entre personnes de différentes générations.
« De l’aube claire jusqu’à la fin du jour… »
Il y va de l’amour, dans l’essai de Thomas O. St-Pierre, et si le mot n’est pratiquement jamais écrit, c’est, je crois, en raison du risque de tomber dans le kitsch, ou le cucu – selon le Larousse : « Qui est niais, sot et naïf ou qui est démodé, un peu ridicule ». L’amour, vraiment?
Est-ce l’âge, qui fait émerger l’amour comme solution au mépris du monde, à la haine des vivants? Même l’auteur beat William S. Burroughs, qui n’est pas reconnu pour son humanisme, en est venu à cette conclusion. Passionné d’armes à feu, Burroughs a tué sa conjointe, Joan Vollmer, en jouant à Guillaume Tell avec un pistolet, en 1951. Dans son œuvre, souvent pornographique et toujours expérimentale, utilisant la technique du cut-up et de la libre association, il dépeint le langage comme un virus. Sorte de pape, ou du moins, de cardinal de la contre-culture occidentale, des années 1950 aux années 1990, il a collaboré avec plusieurs jeunes, à la fin de sa vie, dont le groupe Sonic Youth et Kurt Cobain. Il a aussi passé une journée à manipuler des armes à feu avec les Flaming Lips. Trois jours avant sa mort, des suites d’une crise cardiaque, Burroughs a écrit ceci :
There is no final enough of wisdom, experience – any fucking thing. No Holy Grail, No Final Satori, no solution. Just conflict.
Only thing that can resolve conflict is love, like I felt for Fletch and Ruski, Spooner, and Calica. Pure love. What I feel for my cats past and present.
Love? What is it?
Most natural painkiller what there is.
LOVE.
Terminant ma lecture de Miley Cyrus et les malheureux du siècle, j’ai songé à un fait qui n’est pas mentionné par St-Pierre, mais qui me semble permettre de relancer son propos, dans le contexte québécois. Avoir voulu faire de Gens du pays, de Gilles Vigneault, un hymne national, même officieux, c’était tenter de fonder symboliquement un pays sur l’amour, plutôt que sur la haine. Quoi de plus cucul? Quoi de plus nécessaire?
Le philosophe et pamphlétaire Christian Saint-Germain, grand « modophobe » qui a souligné avec verve, récemment, la dureté des stratégies et des tactiques fédéralistes canadiennes, verrait sans doute, dans cette tentative « artiste », un énième signe du profond manque de réalisme des forces indépendantistes québécoises. L’idéalisme romantique de la génération « flower power » aurait été battu en brèche par l’Histoire…
Vigneault n’est pourtant pas un baby-boomer, puisqu’il est né en 1928. Il est plutôt de cette génération qui a grandi durant la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale, celle des enfants « perdus » des combattants, ou celle des enfants « gâtés » de ceux qui ont construit la bombe atomique – la génération des parents des baby-boomers, la génération des chercheurs de l’antipsychiatrie, des « poucheurs » d’hallucinogènes, des créateurs de guitares électriques et de pédales « fuzz », etc. Cette génération n’est pas tout à fait celle qui déteste Miley Cyrus. Au seuil de la mort, d’autres soucis pèsent que la haine de l’époque et de sa jeunesse – ou du moins, on ose espérer que d’autres soucis pèseront, pour nous, si ce souci est en fait du ressentiment.
 Vigneault a suivi son cours classique à Rimouski, dans les années 1940. Il est le produit d’un système d’éducation catholique, mettant de l’avant, du moins en principe, un Dieu aimant, celui du Sacré Cœur. C’est peut-être cette perspective qui mène Vigneault à énoncer, dans la première strophe de Gens du pays, qu’il reste bel et bien un temps, « au bout de nos jours ». Avec Coyne et Burroughs, ainsi qu’avec Cyrus, peut-être, Thomas O. St-Pierre me semble moins confiant qu’un tel « reste » puisse même exister – mais cela devient une raison supplémentaire pour valoriser l’amour, en dernière instance. Face à cette conclusion apparemment consensuelle – l’éloge de l’amour –, il faut une bonne dose de courage pour réfléchir sérieusement comment l’appel à l’amour a nourri une civilisation qui fait montre d’une violence considérable, depuis plusieurs siècles[4]. Le texte de St-Pierre me semble offrir une bonne propédeutique pour affronter ce qui, bien entendu, relève nécessairement de l’essai.
Vigneault a suivi son cours classique à Rimouski, dans les années 1940. Il est le produit d’un système d’éducation catholique, mettant de l’avant, du moins en principe, un Dieu aimant, celui du Sacré Cœur. C’est peut-être cette perspective qui mène Vigneault à énoncer, dans la première strophe de Gens du pays, qu’il reste bel et bien un temps, « au bout de nos jours ». Avec Coyne et Burroughs, ainsi qu’avec Cyrus, peut-être, Thomas O. St-Pierre me semble moins confiant qu’un tel « reste » puisse même exister – mais cela devient une raison supplémentaire pour valoriser l’amour, en dernière instance. Face à cette conclusion apparemment consensuelle – l’éloge de l’amour –, il faut une bonne dose de courage pour réfléchir sérieusement comment l’appel à l’amour a nourri une civilisation qui fait montre d’une violence considérable, depuis plusieurs siècles[4]. Le texte de St-Pierre me semble offrir une bonne propédeutique pour affronter ce qui, bien entendu, relève nécessairement de l’essai.
Notes
[1] R. D. Laing, Knots, Londres, Penguin, 1970; Darian Leader, What is Madness?, Londres, Penguin, 2011.
[2] À mon sens, il faudrait non seulement remarquer, mais analyser en détails, l’usage récurrent du titre de Perrault, depuis dix ou quinze ans, pour penser la transmission, au Québec. « Pour la suite du monde » n’est pas encore devenu un cliché, à mon avis, mais il me semble que la puissance du syntagme tressaille. Gardons l’œil ouvert, sans nécessairement demander un moratoire, sur tous ces usages.
[3] J’emprunte l’expression à Georges Didi-Huberman, La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte, Paris, Minuits, 2008.
[4] Pensons, par exemple, au rôle structurant du mépris pour Judas, coupable d’avoir « refusé l’amour » par lâcheté. Une thèse récente prend cette problématique de front : Sagi Cohen, Homo Perfidus: An Antipathology of the Coward’s Betrayal, thèse de doctorat, École d’études politiques, Université d’Ottawa, 2018.

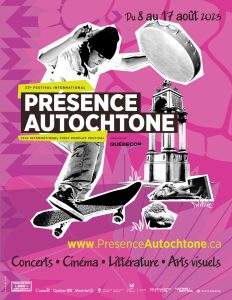








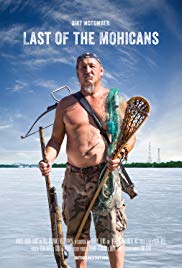




 Dans Miley Cyrus et les malheureux du siècle, Thomas O. St-Pierre propose une « défense de notre époque et de sa jeunesse » placée sous un signe étrange, qui demeure en bonne partie caché, dans l’essai : l’amour. Entre la « modophobie », la peur anxieuse et dédaigneuse de l’ère contemporaine, et la modophilie, sa vénération éhontée et non critique, une ligne d’acceptation lucide, un sillon réflexif se trace en effet, sous la plume de St-Pierre, relançant ce que Friedrich Nietzsche appelait l’amor fati, l’amour du destin, et ce que Hannah Arendt appelait l’amor mundi, l’amour du monde. Comment recevoir un tel livre, au Québec, aujourd’hui?
Dans Miley Cyrus et les malheureux du siècle, Thomas O. St-Pierre propose une « défense de notre époque et de sa jeunesse » placée sous un signe étrange, qui demeure en bonne partie caché, dans l’essai : l’amour. Entre la « modophobie », la peur anxieuse et dédaigneuse de l’ère contemporaine, et la modophilie, sa vénération éhontée et non critique, une ligne d’acceptation lucide, un sillon réflexif se trace en effet, sous la plume de St-Pierre, relançant ce que Friedrich Nietzsche appelait l’amor fati, l’amour du destin, et ce que Hannah Arendt appelait l’amor mundi, l’amour du monde. Comment recevoir un tel livre, au Québec, aujourd’hui?
 Vigneault a suivi son cours classique à Rimouski, dans les années 1940. Il est le produit d’un système d’éducation catholique, mettant de l’avant, du moins en principe, un Dieu aimant, celui du Sacré Cœur. C’est peut-être cette perspective qui mène Vigneault à énoncer, dans la première strophe de Gens du pays, qu’il reste bel et bien un temps, « au bout de nos jours ». Avec Coyne et Burroughs, ainsi qu’avec Cyrus, peut-être, Thomas O. St-Pierre me semble moins confiant qu’un tel « reste » puisse même exister – mais cela devient une raison supplémentaire pour valoriser l’amour, en dernière instance. Face à cette conclusion apparemment consensuelle – l’éloge de l’amour –, il faut une bonne dose de courage pour réfléchir sérieusement comment l’appel à l’amour a nourri une civilisation qui fait montre d’une violence considérable, depuis plusieurs siècles
Vigneault a suivi son cours classique à Rimouski, dans les années 1940. Il est le produit d’un système d’éducation catholique, mettant de l’avant, du moins en principe, un Dieu aimant, celui du Sacré Cœur. C’est peut-être cette perspective qui mène Vigneault à énoncer, dans la première strophe de Gens du pays, qu’il reste bel et bien un temps, « au bout de nos jours ». Avec Coyne et Burroughs, ainsi qu’avec Cyrus, peut-être, Thomas O. St-Pierre me semble moins confiant qu’un tel « reste » puisse même exister – mais cela devient une raison supplémentaire pour valoriser l’amour, en dernière instance. Face à cette conclusion apparemment consensuelle – l’éloge de l’amour –, il faut une bonne dose de courage pour réfléchir sérieusement comment l’appel à l’amour a nourri une civilisation qui fait montre d’une violence considérable, depuis plusieurs siècles





