Critique de Mathieu Bock-Côté, Le multiculturalisme comme religion politique, Montréal, Éditions du Cerf, 2016, 367 p.
Par Julie Perreault
—
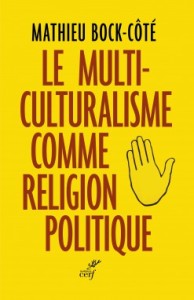 Il est de ces choses qu’on entreprend parfois sans trop savoir dans quoi l’on met les pieds. Comme un marathon sans entrainement, un meuble Ikea un vendredi soir… ou la lecture de Mathieu Bock-Côté en plein milieu de l’été. On se rend jusqu’au bout ou on quitte, mais le chemin n’est jamais facile, et ça nous aura finalement pris jusqu’à l’hiver pour s’y rendre…
Il est de ces choses qu’on entreprend parfois sans trop savoir dans quoi l’on met les pieds. Comme un marathon sans entrainement, un meuble Ikea un vendredi soir… ou la lecture de Mathieu Bock-Côté en plein milieu de l’été. On se rend jusqu’au bout ou on quitte, mais le chemin n’est jamais facile, et ça nous aura finalement pris jusqu’à l’hiver pour s’y rendre…
Dans le cas qui nous concerne, c’est surtout l’écriture qui posa problème. Comment trouver le ton juste pour cette critique? Comment lire et commenter les propos de l’auteur sans tomber dans la caricature antagoniste, souvent violente, qu’il appelle en quelque sorte lui-même?
À proprement parler, je savais avant d’entreprendre la lecture du livre Le Multiculturalisme comme religion politique, que je ne serais pas d’accord avec l’argument central, qui dénonce encore une fois la visibilité trop grande d’une gauche progressiste (laquelle? nous y reviendrons) dans l’espace public. Paradoxalement, la forte présence de l’auteur dans la sphère médiatique fait en sorte que ses idées nous sont un peu connues d’avance, de même que son style, polémiste quoi qu’il en dise.
Par la teneur de mes recherches, je me rattache aussi aux mouvements féministe et critique du colonialisme que l’ouvrage réduit ici sous le chapeau utile et souvent trop large du « multiculturalisme ». Si j’ai tenu néanmoins à faire cette recension, c’était par désir de comprendre un peu mieux la force d’attraction que l’auteur exerce sur plusieurs intellectuels de mon entourage. Certains de mes amis, d’autres ayant marqués mon parcours personnel. Je ne suis pas certaine de mieux comprendre aujourd’hui, mais je sais du moins pourquoi la question mérite d’être posée. Si Bock-Côté a le « culot », comme le disait Louis Cornellier dans une première recension, de soulever des enjeux qui dérangent, sa manière d’y répondre me laisse encore perplexe.
Sans doute la lecture de ce livre posera-t-elle un défi de taille à quiconque n’en partage pas les idées. D’abord, il est long, et le propos répétitif. Ce serait là un moindre défaut s’il n’était pas également maladroit sur le plan méthodologique[1], et si le style de l’argumentaire nous invitait à y rester et à réfléchir avec l’auteur. Or, c’est plutôt l’inverse qui se produit. La volonté de polarisation qui en dessine clairement le contour n’invite pas à la discussion, et cela malgré les prétentions de l’auteur, qui affirme vouloir ouvrir une brèche dans un débat idéologique fermé. Bock-Côté le dit lui-même, il est en guerre, et il s’adresse dès lors à ceux et celles qui sont prêts à le suivre. Ce à quoi j’aimerais répondre, réutilisant à bon compte l’ironie socratique : « dialoguons, ami ». Oui mais… comment?
Bah… tout simplement peut-être, en prenant le discours pour ce qu’il est : ni plus ni moins qu’un discours. Et en invitant quelques amis.
Je ne suis pas polémiste par nature. J’ai le défaut, peut-être, de ne pas aimer la confrontation pour elle-même. Aussi ai-je pris connaissance du livre à travers l’article de Cornellier invoqué plus haut. Le regard hautement positif de l’essayiste, qui se dit le plus souvent de gauche, sur l’intellectuel qui s’affiche lui-même à droite m’a d’abord surpris. Ce n’est pas que je crois à l’étanchéité des catégories idéologiques; au contraire, le spectre gauche-droite me semble plus souvent propice à clore les débats qu’à les ouvrir. Mais tout de même. C’est là une frontière sur laquelle Bock-Côté s’assoit lui-même et qui forme de surcroit l’armature centrale de son dernier livre, lequel s’attache bien plus à construire une gauche monolithique qu’il rejette de front qu’à proposer une critique argumentée du multiculturalisme, fût-il idéologique. Aussi, je m’explique encore mal la conclusion qu’en tire Cornellier : « On peut camper à gauche et tenir à l’héritage occidental. La dissidence, aujourd’hui comme hier, n’est pas une religion et sait faire front commun, malgré les différences, si nécessaire. » C’est à cette idée, surtout, que j’aimerais répondre ici.
Qu’on puisse « camper à gauche », c’est-à-dire être progressiste, et « tenir à l’héritage occidental », n’est pas en soi contradictoire. La gauche, comme concept philosophique, historique, solidifié dans l’Europe du XIXe siècle, demeure après tout un produit de l’Occident. Bock-Côté l’admet lui-même par le geste lorsqu’il critique la formation d’une idéologie gauchiste « diversitaire » issue de la France post-soixante-huitarde. On ne peut dire en ce sens que la notion d’héritage s’oppose en soi à l’idéologie progressiste; la nouvelle gauche qu’il décrit (et décrie) est d’autant plus occidentale qu’elle prendrait naissance en France pour s’étendre à l’ensemble du monde « civilisé », écorchant au passage l’idéologie conservatrice à laquelle il adhère. Chacun des deux n’irait donc pas sans son autre; or, pour l’auteur, il s’agit là d’un objet de critique, et non d’une association bienvenue.
Limiter l’argument à cette posture logique serait néanmoins faire preuve de mauvaise foi. Ce n’est pas à cela non plus que Cornellier répond lorsqu’il reprend pour lui la critique de l’auteur. En fait, il serait plus à propos de dire que Bock-Côté s’oppose à un certain discours progressiste – une gauche anti-occidentale plutôt qu’une gauche an-occidentale –, dont la particularité est à ses yeux de faire le procès injuste de l’Occident. Une gauche qui prône l’émancipation des marges, l’égalité et le respect des différences en s’articulant à des discours anticolonialistes, antiracistes, antitraditionnalistes (gais et lesbiens par exemple), féministes, etc., et dont le principal défaut serait d’annoncer la culpabilité de l’Occident tout entier. L’auteur voit dans tous ces courants réunis (qu’il confond souvent avec le multiculturalisme) la négation de l’intégrité culturelle et historique des nations occidentales au profit de nouveaux et de nouvelles venues qui n’auraient pas contribué à leur essor. Face à ceux-ci, face à celles-là, le devoir de mémoire exigera au contraire une meilleure reconnaissance de l’ordre et des institutions ancestrales, un respect de l’autorité dont (seule) l’idéologie conservatrice est garante.
La notion d’« héritage », on le voit, prend donc un sens particulier au regard de cette critique. Négatif d’abord, puisque qu’il s’agit de répondre à une posture critique; exclusif ensuite, car la notion même de « tradition » se trouve ainsi figée dans l’opposition qui la reconduit, faisant en même temps de la « culture » l’apanage de ceux qui peuvent encore la défendre. La réponse de Cornellier, il me semble, s’adresse à cette partie du discours. Mais celui-ci peut-il encore « camper à gauche », comme il le propose? J’en doute, étant donnée la teneur de la critique défendue par l’auteur du Multiculturalisme comme religion politique.
Par-delà une rhétorique tendancieuse critiquée maintes fois, je reprocherai à Bock-Côté essentiellement deux choses. D’une part, de faire paradoxalement fi de l’histoire (ou de « [confondre] mémoire et histoire », pour reprendre la formule bien sentie de Simon Rainville à propos de Martin Lemay et de son livre sur Duplessis). Et de l’autre, de parler à partir d’un lieu hautement problématique, campé à la fois dans l’idéologie et dans l’obsession d’une France mythifiée. Un lieu problématique pour quiconque vise à dénoncer une « religion politique » (sans en proposer une autre?) et à promouvoir l’idée de nation dans un espace politique – le Québec – qui n’a pas encore réglé le compte de son propre colonialisme. L’importante question de la culpabilité historique, pourtant centrale à l’argumentation, me semble traitée dans la foulée avec une légèreté regrettable. De même que la notion de culture sur laquelle il faudrait revenir.
Comme le faisait remarquer le politologue Alain Noël, l’ouvrage de Bock-Côté tend en effet à escamoter la réalité empirique de son propos, la diversité, au profit d’une argumentation centrée presque exclusivement sur « les ouvrages de quelques penseurs de gauche », qui s’avèreront de surcroit principalement français. Une telle démarche pour le moins dématérialisante permettra à l’auteur de parler d’une « idéologie de la diversité » sans considérer les luttes et les acteurs sociaux qui ont pu l’influencer, la justifier s’il y a lieu, du moins l’expliquer ou nous offrir un socle commun pour en discuter. Au lieu de quoi l’« éthos de la diversité identitaire » (p. 9), réduit à un concept de « religion politique » qui demeure flou tout au long de l’ouvrage, nous est présenté comme un caprice d’élites intellectuelles en manque de reconnaissance. Or, comme le souligne Noël : « Avant d’être une idée, la diversité a d’abord été un fait social. Cette réalité empirique, Bock-Côté n’en prend jamais la mesure. En fait, il ne l’évoque même pas. Et pareillement pour l’histoire. »
Ce faisant, le discours de Bock-Côté me semble omettre deux questions fondamentales : pourquoi ces luttes? Et d’où viennent-elles? Avant d’être reprises par la gauche, les valeurs de la « diversité » sont le produit de rapports de force historiques et de luttes gagnées sur le terrain même de l’« Occident ». L’on pensera ici aux mouvements de décolonisation en Afrique ou dans les Caraïbes (somme toute une extension des rapports de pouvoir européens); aux luttes pour l’indépendance dans plusieurs pays d’Europe et même au Québec; aux luttes pour les droits civils des noirs, des homosexuels et des peuples indigènes aux États-Unis, ou aux mouvements pour le droit des femmes au Canada et ailleurs. Or, aux yeux de Bock-Côté, ces individus de chair et les groupes sociaux auxquels ils appartiennent ne semblent pas faire partie du « peuple », cette majorité normalisée souffrant silencieusement des droits accordés aux « autres » au fil du temps. Ce qui, dans un esprit de polarisation bien réel, leur vaudra d’être placés encore une fois à l’extérieur de l’histoire racontable, une position bien connue pour des individus et des groupes qui ont en commun d’avoir lutté pour l’égalité et le droit d’exister en tant que sujet dans un espace politique où cette possibilité leur était niée de façon systématique.
Aussi, est-ce avoir une vision volontairement fermée de l’histoire que de réduire le mouvement intellectuel des années 1960 aux pavés de la Sorbonne ou aux murs de quelques universités américaines; une stratégie qui vise somme toute à remettre en question la légitimité des luttes contre l’exclusion et les privilèges en rendant invisibles ceux et celles qui les ont portées. Au lieu de quoi Bock-Côté voudrait réifier une idée transcendante du « peuple » qui exclut d’office la moitié de la population, tout en remettant encore une fois la vérité de la culture à une élite éclairée. Quiconque s’est intéressé un tant soit peu à l’histoire des relations entre l’État et les peuples autochtones (voire des relations entre l’État canadien et le Québec) ou au mouvement des femmes, au Canada seulement, sait que la lutte n’est jamais acquise. Le problème avec la notion de « diversité » est sans doute bien davantage d’édulcorer cette réalité que de défendre des valeurs d’égalité et d’inclusion, de toute façon propres à la pensée progressiste depuis le XVIIIe siècle.
La gauche libérale que Bock-Côté semble pointer du doigt n’est pas exempte de critique, loin de là. La political correctness dont elle est parfois porteuse, de même que les politiques de l’identité qui l’organisent, agissent souvent comme frein à la pensée commune. Or, la stratégie de polarisation déployée dans cet ouvrage nous empêche de réfléchir sérieusement à de tels écueils, et prévient de surcroit la possibilité d’une réponse autre que la riposte directe. La rhétorique de l’auteur fait également fi de la critique et des tensions qui existent au sein même des mouvements progressistes, qu’il aurait peut-être intérêt à étudier de plus près pour comprendre leurs particularismes. On s’étonnera par exemple qu’il inclue dans le panier du multiculturalisme des groupes comme les peuples autochtones, qui bien souvent en rejettent eux-mêmes le principe.
Mais la véritable question, pour Bock-Côté comme pour nous, est en fait celle de la culpabilité historique. Elle est le lieu où semblent se jouer plusieurs des luttes idéologiques autour desquelles gravite la notion de diversité; pas étonnant en ce sens qu’elle occupe un chapitre central du livre (chapitre 3 : « La grande noirceur occidentale ou l’histoire de l’expiation », pp. 127-161). Encore une fois, cependant, l’argumentation dans cette section est davantage fondée sur des accusations idéologiques, qui s’attaquent ici aux nouvelles façons de faire l’histoire au XXe siècle, que sur l’analyse de faits historiques concrets. Suivant un révisionnisme conservateur à peine voilé (mobilisant par exemple la mémoire de la Shoah et la critique de l’histoire sociale), le chapitre dénonce en substance l’hégémonie d’une « historiographie victimaire » (p. 130) et d’une « idéologie pénitentielle » (p. 130) qui viseraient à renverser l’ordre mémoriel propre aux grandes « civilisations ». Dans l’esprit de l’auteur, « l’éthos de la diversité » serait ainsi coupable de vouloir rendre coupables les nations occidentales de crimes dont la gravité reste, à ses yeux, irréelle ou exagérée, bien qu’il n’en fasse jamais la preuve. La stratégie rhétorique vise ici à renverser la critique postcoloniale de l’État et de ses institutions en y dénonçant une atteinte à l’intégrité historique des nations européennes; une habitude critique par laquelle « les sociétés occidentales ont appris à avoir honte de leur histoire » (p. 129). Le culpabilisateur est alors rendu coupable de sa propre volonté culpabilisatrice, dans un cercle dont on ne sort apparemment pas. À moins de comprendre les stratégies qui l’animent.
Dans le cas qui nous concerne, il y en a au moins deux. Il faut voir d’abord comment la force rhétorique de l’argument repose sur l’opposition dressée carrée entre la « nation » et la « diversité » – entre le « peuple » et les « autres », la majorité aliénée et ceux et celles qui, de la marge, osent encore revendiquer des droits. Bock-Côté fait jouer ici le pathos romantique qui accompagne le sentiment national pour consolider la frontière identitaire entre ces deux groupes sociaux reconstitués; l’on s’étonnera sans s’étonner que son entreprise de polarisation soit reçue par une certaine gauche nationaliste québécoise. D’une toute autre façon, la rhétorique mobilisée par l’auteur répond aussi d’une propension à euphémiser les réalités historiques qui dérangent, comme le passage suivant le démontre bien :
La cible véritable de cette historiographie victimaire, c’est la nation qui, dans sa construction historique, aurait broyé une diversité identitaire fort complexe à travers des pratiques étatiques qui relèveraient du racisme le plus éculé, par exemple en cherchant à assimiler explicitement les populations immigrées dans le creuset national par des pratiques plus ou moins contraignantes. Il n’y a aucune nation épargnée par le syndrome de la repentance (p. 140; je souligne).
De quoi Bock-Côté parle-t-il ici? D’immigration, de colonisation, de luttes pour les droits civils? Un peu de tout cela et rien à la fois, puisqu’il ne fait pas de véritable distinction entre ces réalités. Or, parler de « populations immigrées » et de « pratiques plus ou moins contraignantes » en invoquant la colonisation, par exemple, est pour le moins déplacé, sinon démagogique et bien mal informé; un renversement performatif que les archives de l’État contrediront facilement. Une façon aussi d’oblitérer la réalité d’un racisme (d’un sexisme, d’une homophobie…) systémique en réduisant à rien les positions qui le décrient, et de passer encore une fois sous silence les pratiques politiques qui sont les vraies coupables. Qu’on ne s’y trompe pas, atténuer l’histoire pour protéger les institutions n’avantage que ceux et celles qui les dirigent, au détriment de la pensée critique, d’abord, et de tous ceux et celles dont la parole est niée ensuite. Or le véritable perdant dans tout cela est peut-être l’idée même de « nation », qui abandonne ainsi la capacité d’être réfléchie et habitée de façon posée, par-delà les oppositions idéologiques et les luttes de privilèges.
Aussi bien, l’appel au peuple et à la nation dont le livre est porteur m’apparaît finalement construit sur un ressentiment qui peine à s’effacer. Quiconque a lu un tant soit peu Albert Memmi y verra l’image du colonisateur qui s’assume doublée de celle de l’aspirant colonisé; deux lieux d’une même volonté de pouvoir qui forment ici un mélange explosif. Que la figure de la métropole imaginaire du Canada français d’avant le Québec soit constamment mise de l’avant dans cet ouvrage n’est sans doute pas un fait anodin; on s’adresse à la France en souhaitant y appartenir, dans un Québec jugé trop petit pour soi. L’appel au peuple défendu par le conservatisme d’un Mathieu Bock-Côté semble ainsi symptomatique d’une honte viscérale (celle de l’élite) qui, tout compte fait, n’est peut-être pas le résultat premier d’un « éthos de la diversité ». Faudrait-il rappeler enfin que la honte n’est pas qu’une tare, mais parfois le début d’un nécessaire retour sur soi?
Note
[1] Les syllogismes utilisés en surabondance sont souvent trompeurs et l’organisation des idées manque d’une cohérence interne élémentaire, sans compter le flou artistique par lequel le discours au « on » ne nomme jamais personne tout en accusant tout le monde.

