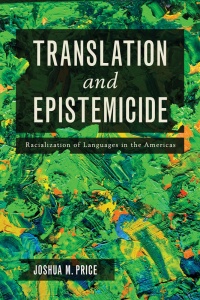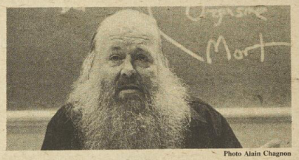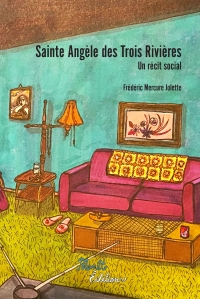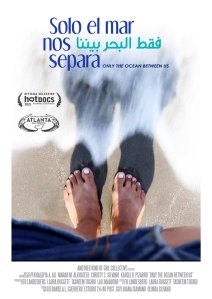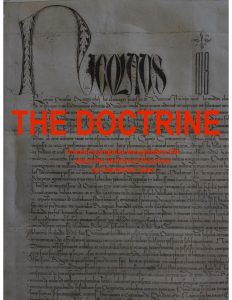Par René Lemieux, Université Concordia[1]
—
Joshua Price analyse dans son livre Translation and Epistemicide (2023) quelques cas de traduction où le passage d’une langue à une autre est souvent synonyme d’une destruction des savoirs dans un lieu donné – ce qu’on nomme depuis Boavantura de Soussa Santos un « épistémicide ». Dans le chapitre 4, intitulé « Translating Performance in Latin America », Joshua Price présente bien les enjeux d’un possible épistémicide dans le domaine de la traduction des sciences humaines et sociales, un champ de la traductologie relativement peu exploré. Il s’agit, en anglais, des « Performance Studies », qu’on pourrait traduire en français par « études de la performance » – mais le peut-on vraiment? Les lignes qui suivent pourraient se voir comme une réflexion sur la traductibilité du nom de la discipline, à défaut de la discipline elle-même que je réserve pour un autre moment.
⁂
Selon Joshua Price, les chercheur·ses des Performance Studies ont un rapport paradoxal au monde « subalterne » de l’Amérique latine. Price fait remarquer que les rapports entre le travail intellectuel du Nord et la « matière » latino-américaine sont déterminés par une certaine division du travail hiérarchisée. Il n’hésite pas à parler d’« appropriation intellectuelle » pour qualifier cette situation :
Yet an ideology often runs in the background. By a kind of circular logic, these ploys have often been justified (sometimes implicitly, sometimes explicitly) by a conceit that only the West does “theory.” “Latin America produces great literature,” a colleague remarked to me, but he went on to say that only Western Europe and the United States produce great philosophy and original theory. The literary contributions and achievements of novelists Gabriel García Márquez, Clarice Lispector, and Juan Rulfo are widely acknowledged in the Western-dominated academy. However, when it comes to theory and philosophy, so this commonplace runs, theory means Western or Eurocentric theory (Price 2023, 109).
En effet, d’origine anglo-américaine, les Performance Studies offriraient la « forme » (ou la theory selon l’expression utilisée par Price), tandis que le monde latino-américain, lui qui produit les multiples manifestations de la « performance », s’occupe du « fond » :
Latin America provides the grist, so to speak, for Europe’s theorizing. Within the worldview of Eurocentrism, Latin America (or South Asia, Arab countries, the entire continent of Africa, and so on) does not produce philosophy. In other words, philosophers, critics, and theorists from the non-West are largely ignored in the European pantheon of analytic and continental philosophy (Price 2023, 109).
Rappelons quand même, ce que ne fait pas Price, que « theory » a un sens particulier aux États-Unis, assez bien explicité par François Cusset dans French Theory (2003) où les auteurs « théoriques » (en particulier provenant de France) gagnent, dans une certaine réception, la capacité à être mobilisés par des champs disciplinaires de plus en plus restreints. Autrement dit, la capacité de déplacement s’agrandit plus le sujet sur lequel porte la théorie est, lui, pointu. Price donne quelques exemples de concepts utilisés, comme la traduction radicale de Quine, la gouvernementalité de Foucault, les rhizomes de Deleuze et Guattari ou la vie nue d’Agamben. On ne s’étonne donc pas de voir cités Foucault en études littéraires, Deleuze en études de genre, Derrida en études architecturales, Baudrillard en études cinématographiques ou Lacan en études juridiques. Le succès d’une réception est souvent dû à la plasticité d’une pensée (souvent française) dont le signe est sa capacité à être reprise par d’autres. Cela ne va pas sans une certaine modalité de l’académie, dominé par l’America ou Anglo-Amérique[2].
⁂
L’analyse de Joshua Price est intéressante à plus d’un titre. Pour les besoins de ce petit texte, je ne rappellerai qu’un point, l’intraduisibilité supposée du terme « performance » en Amérique latine. En effet, on n’hésite pas à affirmer que le terme doit être transféré tel quel. Price cite notamment Diana Taylor :
Despite charges that performance is an Anglo word and that there is no way of making it sound comfortable in either Spanish or Portuguese, scholars and practitioners are beginning to appreciate its multivocal and strategic qualities. The word may be foreign and untranslatable, but the debates, decrees, and strategies arising from the many traditions of embodied practices and corporeal knowledge are deeply rooted and embattled in the Americas (Taylor 2003, 47; citée dans Price 2023, 115)[3].
Je voudrais profiter de ce débat pour discuter, dans un premier détour, de la traduisibilité du terme en français. En effet, comme beaucoup d’autres, j’ai moi-même eu à traduire « performance », et c’est même un exercice que j’ai donné à faire en classe à quelques reprises, notamment dans le cadre d’un cours que j’ai donné à l’Université de Sherbrooke en 2020. L’exercice a été refait à l’Université Concordia avec les étudiant·es du séminaire de traduction avancée en sciences humaines et sociales. Il s’agissait de traduire un extrait d’une intervention de Judith Butler (je mets en évidence les termes qui nous intéressent) :
Another example from Turkey is the “standing man” in Taksim Square in June of 2013 who was part of the protest movements against the Erdoğan government, including against its policies of privatization and its authoritarianism. The standing man was a performance artist, Erdem Gündüz, who obeyed the state’s edict, delivered immediately after the mass protests, not to assemble and not to speak with others in assembly—an edict by Erdoğan that sought to undermine the most basic premises of democracy: freedom of movement, of assembly, and of speech. So, one man stood, and stood at the mandated distance from another person, who in turn stood at the mandated distance from another. Legally, they did not constitute an assembly, and no one was speaking or moving. What they did was to perform compliance perfectly, hundreds of them, filling the square at the proper distance from one another (Butler 2020).
L’exercice ne visait pas à dire aux étudiant·es quelle était la bonne traduction, mais à discuter avec elles et eux la manière avec laquelle ils et elles ont traduit le concept de « performance » (à condition évidemment de le reconnaître comme tel) et ses dérivés. Inévitablement, deux « écoles » se forment parmi les étudiant·es : soit on reconnaît le lien conceptuel entre les deux termes et on tente de trouver des mots pour rendre ce lien, soit on pense que faire ce lien est fautif parce que les ressources terminologiques ne le reconnaissent pas. Dans ce dernier cas, les étudiant·es se réfèrent très souvent à Termium, la banque terminologique alimentée par le gouvernement fédéral. Cet outil nous rappelle que « performance » en anglais devrait se traduire par « spectacle », « interprétation » ou « représentation », ou encore que « street performance » devrait se traduire par « spectacle de rue ». « Performance art » pourrait toutefois être traduit par « performance ». Le terme n’est donc pas exclu. Le nom commun « performer » n’est, lui, jamais traduit par « performeur », on parlera par exemple d’« artiste » ou d’« interprète ». Et le verbe « performer » pour traduire « to perform » est pour sa part jugé comme un anglicisme, comme l’indique une notice de Termium (Services publics et Approvisionnement Canada 2015) :
On doit réserver l’emploi du verbe performer à des objets :
- Un appareil qui performe mieux que le modèle précédent.
- Avec ce système d’exploitation, mon vieil ordinateur performe enfin!
Pour parler de personnes ou de choses abstraites, le verbe performer n’est pas encore attesté en français, bien qu’il se soit répandu. Seuls les termes performance, performant et performeur/performeuse (« athlète qui a obtenu un résultat exceptionnel dans une compétition ») sont répertoriés.
Au Canada, il est toutefois acceptable d’employer cet emprunt critiqué quand il est associé au sport, à la compétition, à l’exploit ou à la réussite remarquable. Dans ces contextes, performer est largement répandu dans l’usage canadien :
- Il nous faudra donc performer, démontrer que nous pouvons et savons le faire. (Le Devoir)
- Les élèves ont bien performé au concours de dictée.
- Cette joueuse de tennis a bien performé.
Le domaine des arts est absent de cette fiche, et on ne penserait jamais l’utiliser comme un verbe transitif[4], ce que l’extrait de Butler demande.
L’autre manière de traduire, celle qui voudrait conserver un lien conceptuel entre les termes, parlerait peut-être d’Erdem Gündüz comme d’un « artiste performeur » ou simplement d’un « performeur », et oserait peut-être ensuite traduire « to perform compliance perfectly » par « performer parfaitement le décret », formulation absolument contraire aux règles actuelles de la langue française. Dans le cadre du cours, j’essaie de faire comprendre aux étudiant·es que les deux solutions sont légitimes, mais seulement selon le contexte de réception de l’auteur ou de l’autrice (voir à ce propos Lemieux 2019). Puisque Judith Butler est reconnue comme une théoricienne de la « performativité », il est tout à fait normal de voir dans les traductions de son œuvre un « accroc » aux règles « normales »[5].
⁂
Pourtant, ce que j’ai perçu dans la manière de traduire que j’enseigne comme une ouverture de la langue française aux nouveautés de l’étranger doit être aussi critiqué, et Joshua Price me permet de le faire. Comme Price le démontre très bien, ce que j’ai vu comme une plasticité nouvelle du français peut aussi se voir comme une forme de colonisation par la traduction. Ce que j’enseignais comme une ouverture vers la différence de l’anglais – une forainisation comme Karen Bennett l’exemplifie de son côté dans son travail sur la retraduction de Foucault (2017) –, pourrait aussi bien se voir comme une nouvelle forme de colonisation par la traduction. Je me propose ainsi de faire un deuxième détour, cette fois par l’étymologie, en questionnant l’origine du mot « performance » qui, en anglais comme en français, s’écrit de la même manière. À première vue, et sans le prononcer, rien ne nous dit si le mot est écrit en anglais ou en français.
J’ai d’abord tout bonnement pensé que le mot était lié étymologiquement à « former », et que le suffixe « per- » était à entendre comme pour le verbe « périr » ou « perforer », c’est-à-dire « passer à travers ». C’est ce qu’on aurait pu croire en lisant le Grand Dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française :
Le verbe performer est un emprunt hybride de l’anglais to perform, lui-même emprunté à l’ancien français parformer. Performer, qui s’emploie en parlant de personnes, d’objets, d’appareils, etc., est d’usage répandu au Québec et très fréquent en français européen. Même s’il est encore critiqué dans certains ouvrages correctifs, cet emprunt est acceptable en français. Le champ sémantique de performer est celui d’une famille ancienne, productive, aux dérivés corrects : le substantif performance est dans la langue depuis le XIXe siècle, l’adjectif performant est largement admis. De plus, cet emprunt s’intègre facilement sur les plans orthographique et phonétique (Office québécois de la langue française 2013)[6].
Et pourtant, l’étymologie est bien plus compliquée. En anglais, les dictionnaires étymologiques indiquent ce qui suit :
c. 1300, performen, “carry into effect, fulfill, discharge, carry out what is demanded or required,” via Anglo-French performer, performir, altered (by influence of Old French forme “form”) from Old French parfornir “to do, carry out, finish, accomplish,” from par– “completely” (see per-) + fornir “to provide” (see furnish). Church Latin had a compound performo “to form thoroughly, to form.”
Si le dictionnaire étymologique en ligne est exact et que le mot anglais vient en fait du français, son origine n’est pas à chercher du côté de « former », c’est-à-dire de la branche noble du français (à savoir le latin), mais plutôt de sa branche bâtarde, c’est-à-dire du francique, car c’est de là que provient « fornir » (aujourd’hui on dirait « fournir », et en anglais « furnish ») :
*frumjan (« accomplir, effectuer ») → voir frommen (« être utile, servir à »), fromm (« observant, servant Dieu, pieux ») en allemand, to frame (« construire, manigancer ») en anglais, de fruma « bénéfice, avantage ».
Ce mot s’est vu ajouter un suffixe, « par- », qui lui vient bien du latin « per- », comme on le retrouve dans « pardon », « parfait » ou « parvenu », marquant un achèvement. La forme « performe » (avec le « per- ») serait en quelque sorte le résultat d’une orthopédie latinisante, celle-là même qui performe au sens de mettre dans sa forme achevée.[7]
Alors qu’est-ce à dire? D’abord que l’origine est obscure, non identifiable, mélangée – métissée (pour utiliser un terme que Price reprend en conclusion de son livre) : une hybridité, una mistura, une mixture, comme le qualifierait peut-être José María Arguedas (2024). On aurait pensé que le terme venait de l’anglais, mais, finalement, son origine était du côté du français, et précisément de sa branche germanique. Tout est question, dès l’origine, d’une certaine « contamination », pour reprendre un terme de la linguistique prescriptiviste, un terme aussi cher à Jacques Derrida, mais pour différentes raisons.
Toute cette dynamique ressemble fort à une autre problématique que j’ai eu l’occasion d’étudier il y a quelques années avec le quasi-concept de « différance » chez Derrida[8]. L’intérêt que j’avais dans ce cas était que cette mobilité entre le français et l’anglais n’est pas du tout évidente en espagnol ou en portugais. Tout comme pour « différance », l’espagnol et le portugais ne produisent pas si facilement les mots en -ance (pas autant qu’en français, ou pas de la même manière). En espagnol, il faudrait parler de « performancia » (un terme qui n’existe pas; le verbe « performar » non plus). En portugais, c’est différent, j’ai vu qu’on se permet d’utiliser « perfórmance » (avec un accent), mais aussi « performância » et « performação ». On pourrait donc conclure que certaines tentatives de « domestication » du mot selon la phonologie de la langue sont possibles en portugais. Autrement, la tendance est forte d’emprunter le terme « performance » directement de l’anglais et d’affirmer simplement son intraduisibilité.
⁂
Que doit-on conclure de ces détours? Peut-être faut-il repenser ce que nous dit Joshua Price, qui, au fond, semble affirmer, d’une manière assez proche de Lydia Liu (1995), que pour penser la performance, les penseurs d’Amérique du Sud ont besoin d’utiliser un concept étranger et de se conformer à ce concept. En d’autres mots, et c’est celui autour duquel on tourne depuis le début, les artistes latino-américains ont besoin de performer le concept. Ce n’est pas tellement différent de la problématique de Lydia Liu avec la langue de la chambre du maître et celle de la chambre d’ami (voir Lemieux 2023) : la langue anglaise transporte un concept comme un invité apporte un cadeau à la personne qui le reçoit, mais rapidement, comme un hôte insolent, l’anglais finit par prendre toute la place, à un point tel qu’on ne peut plus penser qu’avec et dans la « forme » de l’anglo-américain.
Mais si on pouvait espérer, avec Lydia Liu, revisiter une forme ancienne du chinois, classique, dont on aurait pu être nostalgique (c’est l’impression que j’avais eue en la lisant), Price n’offre rien de ce genre : pas d’Ancien Monde sur lequel on pourrait faire retour. Comme pour chacun des chapitres de son livre, Price nous laisse nus devant l’aporie[9] : les Performance Studies nous donne accès aux « performances » de l’Amérique latine, mais aux conditions de la mise en forme de ces performances selon le regard (et le cadre) anglo-américain. En lisant Price, on pourrait se remémorer la formule devenue emblématique qu’offrait l’écrivaine Audre Lorde (1983) : « The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House », qu’on peut voir traduit en français par : « Les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître ». En lisant Price, on pourrait avoir cette impression qu’il veut répondre à la formule choc de Lorde en rétorquant simplement ceci : « Mais que devons-nous faire quand ces outils sont les seuls dont nous disposons? » Peu importe où l’on regarde, il n’y en a pas d’autres : nul passé ne nous ramènera des outils oubliés, nulle transcendance ne nous en apportera de nouveaux.
Sans avoir de solution définitive à apporter – y en a-t-il même une? ne serait-ce pas dans le cas par cas que se décèlerait un mode de vie possible, à chaque fois repensé? –, je repense à ce que disait Barbara Cassin de la relativité en traduction, dans un commentaire sur la réponse que Protagoras donne à Socrate (dans le Théétète de Platon) :
[Protagoras] fait passer de l’opposition binaire vrai/faux au comparatif : « meilleur » et, plus précisément encore, à ce que je propose d’appeler le comparatif dédié : « meilleur pour ». Le meilleur est en effet défini comme « le plus utile », le mieux adapté à (la personne, la situation, toutes les composantes de ce moment que les Grecs nomment kairos, « opportunité »). Où l’on retrouve le sens précis de ces khrêmata dont l’homme serait mesure, non pas les « choses », les « étants » (pragmata, onta), mais ce dont on se sert, les khrêmata, objets d’usage, richesses, à utiliser et à dépenser, richesses dont le langage, les performances discursives, font évidemment partie (Cassin 2010).
À chaque aporie, son issue, à chaque problème, sa traduction, et tout est toujours à refaire.
Bibliographie
Arguedas, José María. 2024. « Entre le qheswa et le castillan : l’angoisse du mestizo ». Traduit par René Lemieux et Ana Kancepolsky Teichmann. Trahir 15 (février). En ligne.
Bennett, Karen. 2017. « Foucault in English: The Politics of Exoticization ». Target. International Journal of Translation Studies 29 (2): 222‑243. En ligne.
Butler, Judith. 2020. « Judith Butler on Rethinking Vulnerability, Violence, Resistance ». Verso (blog). 6 mars 2020. En ligne.
Cassin, Barbara. 2010. « Relativité de la traduction et relativisme ». In La Pluralité interprétative. Fondements historiques et cognitifs de la notion de point de vue, par Alain Berthoz, Carlo Ossola, et Brian Stock. Paris: Collège de France. En ligne.
Cusset, François. 2003. French Theory: Foucault, Derrida, Deleuze et Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux Etats-Unis. La Découverte.
Féral, Josette. 2013. « De la performance à la performativité ». Communications, no 92: 205‑218. En ligne.
Kusch, Rodolfo. 1979. El pensamiento indígena y popular en América. Hachette.
Kusch, Rodolfo. 2010. Indigenous and Popular Thinking in América. Traduit par María Lugones et Joshua M. Price. Duke University Press.
Lemieux, René. 2009. « Force et signification à l’épreuve de la traduction: la différance derridienne et son transport à l’étranger ». Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry 29 (2‑3): 33‑58.
Lemieux, René. 2019. « Traduction philosophique et signature: le cas de l’indécidable derridien entame en anglais ». TTR 32 (2): 217‑42.
Lemieux, René. 2023. « Le pouvoir de la langue de la chambre d’ami: première lecture de Lydia Liu ». Trahir 14 (février). En ligne.
Liu, Lydia H. 1995. Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity—China, 1900-1937. Stanford: Stanford University Press.
Lorde, Audre. 1983. « The Master’s Tools Will Never Dismantle The Master’s House ». In This Bridge Called my Back: Writings by Radical Women of Color, par Cherríe Moraga et Gloria Anzaldúa, 2nd edition, 98‑101. Latham, New York: Kitchen Table: Women of Color Press.
Louder, Dean R., Jean Morisset, et Eric Waddell. 2001. Vision et visages de la Franco-Amérique. Les éditions du Septentrion.
Morisset, Jean. 2019. « Une vie en translation, ou Le vertige et la gloire d’être Franco ». Trahir 10 (mai). En ligne.
Office québécois de la langue française. 2013. « performer ». In Grand dictionnaire terminologique. En ligne.
Ottoni, Paulo. 2012. « Traduire la différance en portugais ». Traduit par René Lemieux. Trahir 3 (novembre). En ligne.
Price, Joshua M. 2023. Translation and Epistemicide: Racialization of Languages in the Americas. Tucson: University of Arizona Press.
Services publics et Approvisionnement Canada. 2015. « performer ». In Termium Plus. En ligne.
Taylor, Diana. 2003. The archive and the repertoire: Performing cultural memory in the Americas. Duke University Press.
Université de Sherbrooke. 2024. « performer ». In Usito. En ligne.
Notes
[1] Ce texte fut d’abord présenté dans le cadre du groupe de lecture de l’Observatoire de la traduction autochtone où, de septembre à décembre 2023, nous avons lu le plus récent livre de Joshua Price. Il s’agissait du deuxième livre lu dans le cadre de ce groupe (le premier étant Translingual Practice. Literature, National Culture, and Translated Modernity—China, 1900-1937 de Lydia H. Liu, qui a aussi faire l’objet d’un commentaire critique). Encore une fois, je tiens également à offrir mes excuses auprès des étudiant·es du séminaire FTRA 612/542 Traduction avancée en sciences humaines et sociales qui ont eu à subir mes élucubrations sur les étymologies compliquées du terme « performance ».
[2] Je fais référence par ces termes à Price lui-même qui, dans sa conclusion, utilise le terme espagnol « América », contre l’anglais America, pour faire connaître cette autre Amérique inaudible pour les États-Unis. Cette idée qu’il reprend de Rodolfo Kusch (1979; Price a cotraduit le livre avec María Lugones en 2010) est très proche des thèses formulées au Québec par Jean Morisset et d’autres, qu’on retrouve parfois sous le nom de « Franco-Amérique » ou d’« Amérique franco ». Voir notamment Louder, Morisset et Waddell (2001) ainsi que l’article « Une vie en translation, ou Le vertige et la gloire d’être Franco » (Jean Morisset, Trahir 10, 2019).
[3] Comme il s’agit ici d’une chercheuse américaine, la critique peut sembler un peu facile. Or Price donne beaucoup d’autres exemples, y compris par des artistes latino-américains (Price 2023, 118 sqq.).
[4] Le Grand Dictionnaire terminologique (Office québécois de la langue française 2013) et Usito (Université de Sherbrooke 2024), des ressources terminologiques bien plus à jour que Termium, acceptent le verbe « performer » au sens de « faire, donner, offrir une performance artistique », mais il est toujours intransitif.
[5] L’usage de « performer » comme verbe transitif, sans être très courant, est tout de même repérable dans les publications en français. Pour ne donner qu’un exemple où l’on met en relation les Performance Studies et Judith Butler : « Performer l’identité à travers le genre, la race ou toute autre construction culturelle, c’est donc aussi la jouer, tout comme nous jouons à être ou à nous comporter de telle ou telle manière dans notre environnement culturel et social. » (Féral 2013, 215)
[6] Usito explique l’étymologie de manière encore plus simple. Pour « performer » : « 1985 (in TLFQ); de l’anglais to perform »; et pour « performance » : « 1839; mot anglais ».
[7] Je dis « orthopédie » parce que c’est de la noblesse du latin que vient la forme finale de « performer », mais si cela avait été d’une langue jugée moins noble, comme le francique ou le bas-breton, on aurait facilement parlé de « corruption ». Il faudra bien un jour prendre conscience de notre manière de parler des relations entre les langues, en particulier en traductologie, et repenser notre rapport à l’indemne et à l’intact.
[8] Voir notamment Lemieux (2009) et ma traduction de Paulo Ottoni (2012) pour une discussion sur la traduction portugaise de « différance ».
[9] Je fais évidemment référence au concept de « desnudo » que Joshua Price utilise en conclusion de son livre et qu’il emprunte au conquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca.